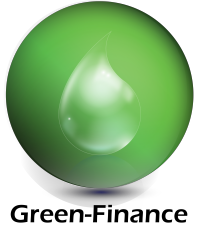La finance durable doit évoluer pour rester crédible. En marginalisant le secteur de la défense, elle ignore des enjeux clés de souveraineté. L’ESG doit intégrer rentabilité, discernement et réalisme pour financer efficacement la sécurité européenne. Moins dogmatique et plus pragmatique, elle pourra ainsi redevenir utile à la société.
L’ESG confrontée à ses propres contradictions
L’investissement durable s’est développé autour de valeurs fortes, cherchant à concilier performance financière et impact sociétal. Pourtant, face aux défis actuels, certains principes fondateurs de la finance ESG montrent leurs limites. Notamment lorsqu’ils entravent des secteurs stratégiques comme la défense, essentiels à la stabilité de l’Europe.
Deux grandes idées ont façonné cette finance : l’intention prime sur le résultat, et le monde peut être séparé en bien et mal. Ces visions, trop idéalisées, freinent aujourd’hui la capacité de l’ESG à répondre aux réalités géopolitiques.
L’investissement responsable a besoin de rentabilité
En privilégiant l’intention à la rentabilité, la finance durable a soutenu de nombreux projets peu viables économiquement. Résultat : une perte de confiance des investisseurs. Beaucoup associent désormais « durable » à « non rentable », freinant ainsi les flux de capitaux vers les solutions ESG.
De plus, la multiplication des fonds labellisés ESG sans réelle performance a renforcé cette perception. Pour regagner en crédibilité, l’ESG doit renouer avec une logique économique simple : c’est la rentabilité qui attire les investisseurs et pérennise les engagements.
Un manichéisme devenu contre-productif
La deuxième faiblesse structurelle de l’ESG tient à sa vision binaire du monde. En cherchant à définir unilatéralement ce qui est « vertueux » ou « nuisible », elle a parfois écarté des secteurs entiers sans nuance ni débat.
L’exclusion automatique des majors pétroliers, sans prendre en compte les besoins énergétiques de l’Europe, illustre cette tendance. Le secteur de la défense est lui aussi victime de ce raisonnement dogmatique, alors qu’il joue un rôle clé pour la sécurité collective.
Défense : un secteur marginalisé par idéologie
Historiquement, la finance durable a évité tout lien avec l’armement. Elle a d’abord ciblé les armes controversées, puis les armes nucléaires, et enfin les armes conventionnelles. Cette exclusion progressive repose sur le principe du « ne pas nuire » (DNSH) promu par les standards européens.
Pourtant, dans un monde instable, refuser d’investir dans la défense revient à ignorer un pilier fondamental de la paix durable. De nombreux investisseurs ESG se retrouvent, sans le savoir, exclus de groupes industriels majeurs comme Airbus ou Thales, pourtant engagés dans l’innovation et la sécurité.
L’Europe face à un tournant stratégique
Le conflit en Ukraine a remis la question de la souveraineté européenne au centre du jeu. Une paix stable passe par des capacités de défense crédibles. Ce constat rend obsolète l’approche actuelle de l’ESG vis-à-vis de ce secteur. L’exigence d’un cadre plus pragmatique devient urgente.
Déjà il y a un an, certains appelaient à repenser la finance durable pour qu’elle reste utile, rentable et pertinente. Aujourd’hui, cette nécessité devient évidente : l’ESG doit intégrer des critères de discernement, de réalisme et de performance économique.
Vers une ESG plus mature et mieux alignée
Si elle veut continuer à jouer un rôle central dans le financement de la transition, la finance durable doit évoluer. Elle doit :
- Revaloriser la rentabilité comme condition de succès
- Sortir du dogmatisme au profit d’un jugement nuancé
- Adopter une boussole réaliste, centrée sur l’utilité sociétale
Le monde change, les priorités aussi. La finance ESG a une opportunité unique : devenir moins moralisatrice, plus pragmatique, et renforcer son impact réel. À défaut, elle risque de perdre son influence au moment même où elle pourrait être la plus utile.
Découvrez aussi : Souveraineté énergétique : l’Europe face au défi industriel