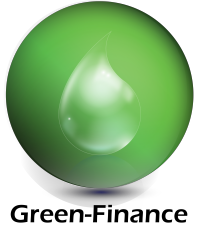Alors que les États-Unis viennent de lancer avec succès leur premier vol habité à destination de la Station Spatiale Internationale grâce au lanceur SpaceX développé par une entreprise privée, une première. Mais, en temps de crise écologique, sociale et morale, la conquête spatiale demeure-t-elle une aventure pertinente et porteuse de rêves ? L’astrophysicien Aurélien Barrau questionne la démarche dans ce texte.
Le spatial fascine. Les fusées font rêver. Les navettes émerveillent. Mais ce rêve contribue aujourd’hui à alimenter un peu du cauchemar à venir. Il est légitime de l’interroger. Curieusement pourtant, questionner le bienfondé du « spatial » choque, ulcère, scandalise. Comment si le cœur dur du génie humain s’était ici – et nulle part ailleurs – logé. Peut-être est-il pourtant nécessaire de dépasser ou de renverser ce mythe. Sans la moindre velléité nihiliste ou provocation aigrie, il ne s’agirait que de ré-enchanter un autre rapport à l’espace.
Avec les fusées, l’Univers ne nous est pas devenu accessible. Rappelons que si l’on ramène la taille de la Terre à celle d’une orange, la Station Spatiale Internationale se trouverait à une distance de celle-ci qui équivaut à… l’épaisseur de sa peau ! Quant à la distance entre la Terre et la Lune, elle n’est, comparée à celle de notre Galaxie, qu’un dixième de l’épaisseur d’un cheveux par rapport à la Terre … Et notre Galaxie n’est, elle-même, qu’une infime « molécule » dans le fluide cosmique. Il serait donc totalement insensé de ressentir nos minces envolée spatiales comme un accès réel à l’Univers profond. Il n’en est rien.
La frontière disparue n’est donc pas celle qui nous sépare des espaces interstellaires. Celle-ci demeure bel et bien. Ce sont plutôt les frontières arbitraires de nos pays, de nos états, de nos nations, dont l’inexistence physique s’est imposée avec un très paradoxal étonnement aux quelques spationautes ayant pu observer la Terre depuis l’espace qui volent ici en éclat. Et c’est une belle chose, en effet. Il semble que nous ayons si profondément intégré ces murs factices que leur absence dans le paysage réel nous choque drastiquement. Nous avions oublié la superficialité et l’obsolescence de ce morne quadrillage imposé au réel. Que des hommes surentrainés, surdiplômés et surqualifiés parviennent à s’étonner de la continuité du territoire ne dit pas rien.
D’autant que les frontières ne concernent finalement presque personne. Bien-sûr, elles peuvent avoir des effets létaux. Bien-sûr, les réfugiés – et l’actualité nous le rappelle tragiquement – meurent devant les frontières closes. Cette violence brutale n’est pas chimérique. Mais, à l’échelle de la Vie, les frontières n’existent pas. Des milliards de milliards de vivants appartenant à des millions d’espèces traversent chaque jour les frontières sans en avoir la moindre conscience ni la moindre gêne. Ni les oiseaux, ni les abeilles, ni les lombrics, ni les souris, ni les arbres (qui se déplacent de génération en génération), ni les microbes … ne connaissent les frontières. Notre partition du monde est presque ridicule dans son arrogante vacuité. Nous l’avions crue fondée et presque rigide.
Mais le spatial pose également une question éminemment symbolique, au-delà de ce qui concerne les seules frontières. Son intérêt scientifique est faible. Sans commune mesure avec les moyens humains et financiers qu’il requiert. La démarche est presque exclusivement symbolique. Mais de quoi est-elle le symbole ?
Les missions Apollo ne manquaient pas d’un certain panache. Un véritable parfum d’aventure, qui n’était pas surfait, accompagnait les pionniers de l’espace. Une certaine retenue – pour ne pas dire une forme de sacralité – marqua même les premières sorties extravéhiculaires. La confrontation à l’altérité radicale du sol lunaire invitait à la solennité. Malgré le patriotisme acharné qui sous-tendait la démarche – visant à rattraper le retard sur les Russes –, quand les astronautes revinrent sur Terre, il furent d’ailleurs moins accueillis en héros américains qu’en véritables ambassadeurs de l’humanité. Quelque chose de puissamment émouvant avait lieu. Quelque chose qui sonnait juste.
La symbolique ne s’est-elle pas retournée ? Très rapidement retournée. Les missions Apollo suivantes révélaient déjà un infléchissement notable des attitudes. On trouvait chez les astronautes des gestes de « cow-boys » qui plaisantaient presque grassement, roulaient des mécaniques, exhibaient un peu de leur aisance virile. La magie était déjà en partie perdue.
Aujourd’hui, une entreprise privé américaine s’enorgueillit d’un nouveau lancement. Celui-ci n’est en rien un exploit : depuis bien longtemps les humains maîtrisent cela. Naturellement, quelques innovations peuvent être mises en avant mais la nouveauté profonde est que, pour une fois, l’opération n’est pas mise en place par un état mais par une société privée à but lucratif. Un société aux mains de l’homme, Elon Musk, qui s’enorgueillissait d’avoir mis une automobile sur orbite tandis que Donald Trump semblait souhaiter relancer un programme lunaire tempétueux sans autre enjeu que de défier les chinois. Quel sens cela revêt-il quand la vie sur Terre se meurt ? Sans mentionner que quelques milliardaires – ayant généralement eux-mêmes largement contribué à dévaster notre planète – commencent à envisager de migrer vers l’espace lorsque la Terre sera invivable. Naturellement ils n’y parviendront pas, c’est scientifiquement insensé, mais l’image est lourde, presque insupportable. D’autant que ceux qui envisagent de fuir sont les premiers responsables du naufrage.
L’éventualité de la construction d’un hôtel spatial pour ultra-riches a été récemment évoquée. Le tourisme orbital pour grands patrons est un secteur qui s’annonce porteur. Des dizaines de milliers de satellites sont également en train d’être déployés – nuisant dramatiquement à la possibilité même d’une astronomie digne de ce nom – pour faciliter l’accès à Internet depuis les lieux les plus reculés du globe. Réussir à souiller le ciel lui-même, qui semble donc bel et bien appartenir maintenant aux entreprises, ruiner son irremplaçable charge symbolique, est un « exploit » qui laisse rêveur. Tout cela, d’ailleurs, en grande partie sous l’impulsion du même homme, Elon Musk, qui s’enorgueilli de commercialiser un lance flamme pour jouer à Rambo et qui présente tout juste un pick-up quasi-blindé au dessin futuriste pour amuser les californiens en manque de gadgets de 2 tonnes (celui-ci devrait en outre bénéficier d’une technologie de nettoyage des vitres au laser : la silicon valley pleure d’émotion devant ce prodige). Le milliardaire – récemment apparu s’étouffant de rire en apprenant que l’image d’une biche morte noyée était bien réelle – annonce également l’obsolescence du langage humain. Veillant avec un zèle frénétique aux bénéfices de ses entreprises, il qualifiait il y a peu le confinement américain de « fasciste » alors même que les États-Unis approchaient des 100 000 morts dus au SARS-CoV-2. Mais, au-delà de ce que ceci peut révéler d’un état d’esprit pas tout-à-fait anodin, peu importe finalement la psychologie troublée (et droguée) du PDG de Space X : la question est bien plus profonde et ne relève évidemment pas primitivement d’une personnalité spécifique dont la critique ad-hominen ne présente aucun intérêt fondamental.
L’envolée spatiale a sans doute été – à tort ou à raison – associée à un certain héroïsme libertaire. La symbolique me semble s’être radicalement retournée. Elle relève aujourd’hui, à mes yeux, d’une sémiotique de l’arrogance. N’est-elle pas devenue un jeu de domination stérile et une fabrique de héros factices ? Hors de tout enjeu scientifique, éthique ou esthétique. Hors de toute élégance épistémique.
Alors que la crise écologique majeure qui nous menace plaide aujourd’hui – en particulier pour notre propre survie – en faveur d’une redécouverte rapide de la sobriété, quel sens y a-t-il à se ruer sur une constellation satellitaire, opérée par une société privée, permettant de décupler l’usage, terriblement énergivore et désocialisant, des technologies numériques ?
Alors que nous n’avons manifestement tiré aucune leçon de la crise Covid-19 et que les incitations gouvernementales à retourner urgemment à une consommation débridée se font entendre, quel sens y a-t-il à s’extasier devant le faux exploit consistant à expédier, dans un déluge de feu, quelques centaines de tonnes de métal, de carbone et de kérosène à quelques centaines de kilomètres d’altitude ?
Les populations animales s’effondrent, les espaces sauvages fondent à vue d’œil, la température grimpe en flèche, la pollution empoisonne l’air, l’eau et les sols … la vie sur Terre va mal. C’est vers elle que les regards et les amours devraient se tourner. Elle est soumise à une agression majeure : une extinction massive qui confine en réalité à l’extermination délibérée. Quel étrange cynisme que de désirer aujourd’hui « conquérir » l’espace quand nous dévastons notre propre monde avant même de l’avoir réellement connu. Des relations symbiotiques complexes entre les arbres aux comportements subtils des insectes, en passant par les affects de petits mammifères, nous ne savons presque rien des merveilles qui nous entourent. Faut-il achever de détruire toute cette magnificence délicate émanant de milliards d’années d’évolution ininterrompue pour tourner nos regards vers les ocres monotones et exsangues du sol martien ?
Évidemment, la quête de connaissances doit se poursuivre ! Il n’est pas un instant question que la conscience écologique mette fin à l’aventure du savoir. Tout au contraire. Il est d’ailleurs vrai que certains satellites aident à comprendre le changement climatique ou à répondre à des questions astrophysiques. Mais la conquête spatiale au sens fort – en particulier les vols habités – a bien peu à voir avec l’humilité douce et patiente de l’authentique découverte du monde. Elle a pris, aujourd’hui, le visage d’une démiurgie prétentieuse. Et, même pour ce qui concerne les vols non-habités, il y a peu de risque à parier sur l’émergence prochaine de publicités cosmiques qui deviendront le véritable enjeu puisque, dans les faits, nous avons essentiellement privatisé le ciel.
Comme une dernière érection nihiliste, les immenses structures phalliques des fusées signent un peu de la faillite d’une humanité arrogante et aveugle. D’une humanité qui a perdu la vérité de l’ici dans sa soif d’un ailleurs fantasmé. Une humanité dont la soif de désacralisation macule jusqu’à l’inchoatif des élans qui auraient pu être dignes de sens.
L’incapacité de l’Occident – au sens large – à déconstruire ses propres valeurs même quand, en plus des ravages néocoloniaux, elles conduisent à son propre suicide, laisse rêveur.
L’ « étoffe des héros », c’est maintenant – me semble-t-il – celle des indiens qui luttent pour la survie de la forêt, celle des réfugiés qui luttent pour la survie de leurs familles, celle des animaux qui luttent pour la survie de leurs meutes ou de leur hordes dans un anthropocène dévasté. L’astronaute, devenu, malgré lui sans doute, l’image stéréotypée, formatée et aseptisée, de l’hubris mortifère de notre société décadente a perdu sa superbe. La planète qu’il faudrait apprendre à explorer – sans la conquérir – c’est la nôtre. Des rêves magnifiques et hautement inspirants peuvent fleurir à l’infini dans la magie d’une forêt ou d’une montagne. Maintes cultures ont inventé des rapports au monde moins vaniteux que les nôtres et il ne tient qu’à nous de les découvrir enfin. Le temps presse et la révolution à opérer est autrement plus radicale que la découverte d’une nouvelle technologie ou d’un moteur surpuissant : il s’agit de réapprendre à aimer. Loin d’un renoncement, il faut maintenant un ré-enchantement infiniment plus profond et exigeant que le supplétif pauvre procuré par quelques monstres techniques disgracieux, laborieusement propulsés pour tenter d’échapper à la… gravité.
Une analyse d’Aurelien Barrau