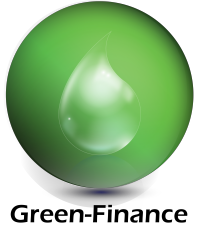En rayon, les produits ne font plus mystère de leurs valeurs
nutritionnelles ou de leur composition. Mais il n’existe aucune étiquette
faisant état de la quantité d’émissions de CO2 générées par leur
production.
Elles indiquent les valeurs nutritionnelles, les additifs alimentaires (les
fameux E, suivis d’un numéro) ou vous assènent même un tranchant
«Fumer tue», à titre de rappel. Les étiquettes de l’agroalimentaire
continuent pourtant largement à ignorer les questions environnementales.
Alors pourquoi les produits que nous consommons ne contiennent-ils pas
de mention de leur bilan carbone?
WWF, qui a créé une calculelette d’empreinte écologique.
L’outil, disponible en ligne, reète les habitudes d’un consommateur, et non le bilan d’un produit en particulier. Mais il prouve que les données existent.
«Le WWF a commandé un écobilan de certains fruits et légumes»,
conrme une porte-parole. On apprend dans ce rapport de 33 pages qu’ils
représentent 2 à 3% des émissions de CO2 des ménages suisses, 16% des
émissions liées à la nutrition.
Papaye et asperge, reines du CO2
Dans le classement particulier des fruits et légumes les plus nocifs, c’est la
papaye qui remporte la première place avec l’équivalent de près de 10 kilos
de CO2 émis par kilogramme consommé. Elle est toutefois devancée par
l’asperge verte, lorsque celle-ci vient du Pérou par avion via Chicago (15
kilos), plutôt que par bateau du Brésil (3 kilos). Dans le duel des produits
aériens, l’avocat chilien pointe à la deuxième place (13 kilos).
L’affaire se complique un peu plus lorsque l’on tient compte de la
consommation totale des Suisses (les fruits et légumes ne sont plus
pondérés par kilo). Ici, ce sont les agrumes qui pointent en tête avec
l’équivalent de 45 tonnes de CO2. Suivent l’asperge verte et la tomate avec
environ 32 tonnes chacune.
Le rapport fournit également la ventilation des différents types d’émissions
(transport, fertilisants, stockage). L’asperge verte est nocive parce qu’elle
prend très souvent l’avion. Si vous ne pouvez pas vous passer de tomates
en mai, favorisez sa version espagnole: le camion pollue moins que le
chauffage de la serre.
Standardiser, c’est dur
Si toutes ces données existent, pourquoi ne figurent-elles pas sur les
étiquettes Niels Jungbluth, directeur de ESU-Services, un cabinet de conseil en durabilité basé à Schaffhouse, rappelle qu’une tentative a déjà
eu lieu en France avec ses lois Grenelle en 2010 ou chez Walmart avec ses
labels d’intensité carbone. Avec tous les problèmes que cela peut poser en
termes de standardisation, surtout pour des groupes agroalimentaires
opérant sur plusieurs pays.
«L’Union européenne élabore actuellement des lignes directrices pour les
calculs d’empreinte écologique. En attendant, a suisse évitera de développer sa propre approche”, parie Niels Jungbluth.
Parmi les pierres d’achoppement: les diffcultés à défnir une unité, de café
par exemple, ou à caractériser quel type d’impact devrait mesurer le label
(celui de l’usine de production ou du transporteur). «Il y a trop d’intérêts
en jeu pour que l’on arrive à une solution simple pour le consommateur,
du type feu de signalisation», conclut le scientifique.
Une norme ISO pour le CO2
Niels Jungbluth ne voit pas non plus de solution miracle dans la norme
ISO 14067. Mise à jour en août dernier, elle dénit une nomenclature pour
quantier les gaz à eet de serre d’un produit. Un accord international
façon «plus petit dénominateur commun», selon lui, qui laisse de
nombreuses questions méthodologiques en suspens.
Du côté du WWF, on pointe un autre problème: l’efficacité des étiquettes.
«Nous doutons que cette information puisse réellement modifier la consommation», précise une porte-parole. Avant de
dresser un parallèle avec les indications sur les valeurs nutritives, qui n’ont
pas permis de «diminuer la vente d’aliments à forte teneur en sucre ou en
matières grasses».
L’ONG a donc décidé de se concentrer sur les entreprises, plutôt que de
tenter de changer le comportement des consommateurs.
Adrià Budry Carbó – Le Temps