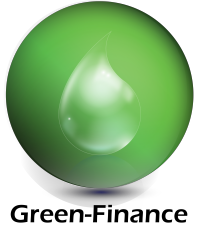L’ancien ministre de la transition écologique juge que le projet de loi «climat et résilience», qui sera présenté le 10 février en conseil des ministres, n’est pas à la hauteur des enjeux.
Réfléchir au «comment faire» et explorer les «angles morts» des politiques publiques pour parvenir à mettre véritablement en œuvre les mutations environnementales et sociales : l’ancien ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, par le biais de la fondation qui porte son nom et qui fête ses 30 ans, entend peser à travers son think tank sur le prochain quinquennat en proposant des «feuilles de route concrètes», dont les trois premières porteront sur les pesticides, les importations et le secteur automobile.
Un outil pour faire en sorte que les promesses des responsables politiques soient tenues et pour répondre à la crise de confiance «inquiétante» entre citoyens et politiques.
Quel regard portez-vous sur la crise sanitaire et sa gestion, près d’un an après qu’elle a démarré ?
Je comprends la crainte, la souffrance, l’angoisse de millions de citoyens, mais je comprends aussi la difficulté du gouvernement à faire face à une situation qui n’a pas d’équivalent. C’est une crise totalement inédite, fluctuant au jour le jour et avec des paroles divergentes de scientifiques. Dans ce bruit de fond, l’exercice démocratique et politique est sur la corde raide.
Ce qui m’intéresse, c’est ce que l’on peut faire en amont des crises et les enseignements que l’on peut en tirer ensuite, mais, lorsqu’on est au cœur du vortex, il faut faire preuve d’un minimum de solidarité et d’unité. Mais j’espère que cette crise sanitaire ne fera pas d’ombre à d’autres crises, comme la crise écologique. Elle doit au contraire l’éclairer, notamment sur la nécessité de mettre des moyens en amont, quand on peut encore atténuer le choc.
Que pensez-vous du contenu du projet de loi « climat et résilience » issu des travaux de la convention citoyenne pour le climat ?
Ce que les experts nous disent, c’est que ce projet de loi en l’état n’est pas à la hauteur des enjeux et de nos engagements : ni de l’objectif de réduire nos émissions de 40 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, et encore moins du nouvel objectif européen de les abaisser d’au moins 55 %. Sur tous les sujets, qu’il s’agisse de la rénovation des bâtiments, de la fin des véhicules polluants ou des aides d’Etat dont ont bénéficié les grandes entreprises pour se relever de la pandémie, c’est toujours le plus petit dénominateur commun qui est employé. C’est dommage parce que l’important travail de la convention citoyenne donnait l’occasion au gouvernement de se rattraper pour la fin du quinquennat. Tout n’est pas joué puisqu’il y a encore le travail du Parlement. Mais le problème, c’est que l’écart énorme entre les promesses politiques et la réalisation des promesses aggrave la défiance entre le citoyen et le politique, ce qui sape notre démocratie.
L’Etat vient d’être condamné pour « carence fautive » dans la lutte contre le dérèglement climatique. Quelle portée ce jugement peut-il avoir ?
Il y a une valeur historique, car la justice rappelle l’Etat à l’ordre. Elle répète, là encore, que la République et l’Etat ne peuvent pas faire des promesses qu’ils ne mettent pas en œuvre.
Pensez-vous que le projet de loi pour intégrer l’environnement dans l’article Ier de la Constitution aboutira ?
Je ne crois pas qu’il y aura un référendum avant la fin du quinquennat, même si je peux me tromper. Sur le fait de parvenir à réunir les deux chambres sur un texte qui ne soit pas simplement symbolique, je n’en mettrais pas ma main au feu, non plus… On n’a pas besoin seulement de symboles, on a besoin de leviers, notamment juridiques, pour pérenniser l’action. Cela serait un acte structurant d’inscrire cette phrase dans la Constitution.
Quels sont les principaux verrous à la transition écologique ?
D’abord, il y a le problème de la méthode : quand on se fixe des objectifs à 2030 ou a fortiori 2050, il faut des points de passage pour les réaliser. Mois après mois, il faut regarder où l’on en est et adapter les moyens en fonction des réussites et des échecs. En France, il n’y a jamais de rappel à l’ordre si l’on n’est pas dans les clous. Cela implique aussi d’anticiper les secteurs et les personnes qui vont être affectés par ces évolutions et de les accompagner. Une mutation, une transition, ou une métamorphose, comme le dit Edgar Morin, ça s’organise et se planifie. Sinon, nous arrivons à une impasse. Au moment où on remet à l’ordre du jour le commissariat au plan, ce dont je me réjouis, je me désole de ne pas avoir entendu une seule fois François Bayrou [haut-commissaire au plan depuis septembre 2020] et les autres responsables politiques parler de la transition écologique et sociale.
Après, il y a la question des moyens, normatifs, réglementaires et législatifs. Quand on ne met pas dans la loi la sortie du glyphosate, on ne s’en fixe pas la contrainte. Et la contrainte n’est pas l’ennemie de la créativité, elle en est la condition. Il y a aussi la question des outils, des marchés publics, le levier des accords commerciaux. C’est toute une stratégie qu’il faut mettre en œuvre sur le « comment ». Enfin, il y a une question de cohérence : quand on demande à nos agriculteurs de réduire les pesticides, de ne pas utiliser d’OGM, et que, dans le même temps, on en importe grâce à des traités de libre-échange et que l’on s’autorise à exporter certaines substances dangereuses comme l’atrazine, on crée des distorsions. On n’est alors pas dans les bonnes conditions pour respecter les objectifs.
En matière de transition énergétique, pensez-vous qu’il faille construire de nouveaux réacteurs nucléaires ?
Ma position sur le nucléaire n’a pas changé, elle s’est même confortée. Le nucléaire est un puits sans fond sur le plan économique, on ne maîtrise plus aucun coût, ni dans le démantèlement, ni pour le « grand carénage », ni sur les nouveaux EPR. Il y a une fuite en avant que je ne comprends pas. L’argent que l’on met dans ce domaine ne sera pas mis ailleurs, et notamment dans l’efficacité énergétique. On a abandonné ce point crucial de la transition énergétique qu’est la réduction de notre consommation.
Comment avez-vous interprété le rapport de RTE et de l’AIE sur le scénario 100 % renouvelable ?
Je n’affirmerai pas que la France pourrait pourvoir, en l’état, à l’ensemble de ses besoins en énergie avec 100 % de renouvelables dans un délai court. Mais ce rapport confirme que, sur l’électricité, c’est techniquement possible. Il faut continuer progressivement à diminuer le parc nucléaire en fonction de la réduction de notre consommation et du développement des renouvelables.
Souhaitez-vous porter ces objectifs et être candidat à la prochaine présidentielle ?
J’ai une telle conscience de la gravité et de la complexité de la situation que le prochain locataire de l’Elysée aura à gérer qu’à aucun moment je ne prétends être cette personne-là. Mon rôle sera collectif, pas personnel. Il n’y aura pas d’homme ou de femme providentiel. Il y aura un socle citoyen qui va faire émerger un certain nombre de propositions, d’aspirations.
Qui pourra l’incarner ? Ce sera un collectif de personnes.
Soutiendrez-vous un ou une candidate ?
Ce n’est pas à l’ordre du jour. Parlons des idées, des projets mais aussi des moyens. Il faudra distinguer qui est vraiment écologiste, qui remet à plat un modèle qui épuise et un modèle qui concentre. On jugera sur le « comment ». A titre personnel, si quelqu’un sort de l’ombre et me semble avoir la crédibilité, la confiance, la probité, l’honnêteté, le sang-froid et l’énergie, je serai ravi !
Voterez-vous à la primaire des Verts ?
Je ne me suis même pas posé la question.
Le contexte international, avec l’arrivée de Joe Biden notamment, vous paraît-il plutôt favorable à l’action climatique ?
Il ne faut pas attendre de miracle mais le multilatéralisme, mis à l’épreuve par Donald Trump, va pouvoir retrouver un peu d’éclat et d’efficacité. J’ai vu la rapidité avec laquelle le président Biden a décidé de revenir dans l’accord de Paris, et l’ancien secrétaire d’Etat John Kerry [nommé représentant spécial pour le climat] est un allié.
Il aura, je pense, une diplomatie offensive sur le sujet. Mais où est passée la diplomatie écologique de la France ? Lors de la préparation de la COP21 du temps de François Hollande, la diplomatie n’était pas seulement économique, et nos diplomates s’étaient d’ailleurs mobilisés avec beaucoup d’enthousiasme.
A l’international, Emmanuel Macron est présent. Il a une constance dans l’interpellation, la mobilisation. Mais cela se fait au gré d’événements. Notre diplomatie quotidienne, courante, me semble très silencieuse par rapport à ce qu’elle a été. On n’entend pas Jean-Yves Le Drian [le ministre des affaires étrangères] sur ces sujets-là.
Au niveau européen par exemple, la France peut-elle encore peser pour rendre la politique agricole commune plus ambitieuse ?
Nous sommes dans un paradoxe incroyable. Jamais nous n’avons eu de conjoncture aussi favorable pour transformer de manière apaisée le modèle agricole français. Il y a une demande sociétale de produits de qualité et de proximité. Il y a aussi une possibilité de diversifier les revenus des agriculteurs, en les rémunérant pour réhabiliter la biodiversité, stocker du CO2, produire de l’énergie renouvelable. On peut mettre fin à nos importations de produits protéagineux et donc améliorer notre souveraineté alimentaire. On a l’argent de la PAC [politique agricole commune]. Tous les paramètres sont réunis, mais où est la vision ?
Il en va de notre modèle agricole comme de notre modèle économique : ce n’est pas d’ajustements à la marge dont on a besoin mais de programmer sa mutation complète. De passer d’un modèle intensif en intrants à un modèle intensif en emplois. Donc, oui, la France peut encore jouer un rôle, mais, pour l’instant, elle n’est pas sortie de cette confrontation stérile entre enjeux environnementaux et enjeux socio-économiques.
Pensez-vous qu’il reste quelque chose de l’idée du « monde d’après », qui semble avoir disparu des débats ?
Lors du premier confinement, je voyais émerger une forme de sagesse. J’osais encore espérer que c’était un mal pour un bien et que, une fois sortis de cette crise, que j’espérais plus courte, on en tire un certain nombre d’enseignements. Aujourd’hui, je n’en suis plus aussi certain. Il y a eu un monde d’avant et il y aura un monde d’après, qui ne sera plus le même. Mais le sera-t-il d’une manière bénéfique ou toxique ? Sera-t-on capable de mobiliser des moyens et de transgresser certaines règles qu’on s’impose en amont des crises ? Pourra-t-on avoir un vrai débat sur ce qu’on fait de la dette, sur les financements ? Saura-t-on être disruptifs ? Honnêtement, je n’en sais rien. Mais on ne sortira pas de cette accumulation de crises par le haut avec des outils et des méthodes conventionnels.