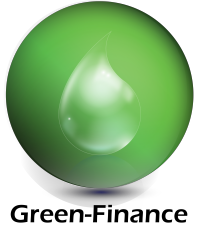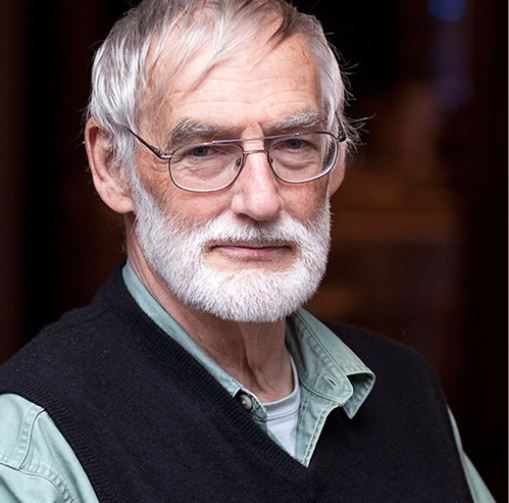
L’auteur du fameux rapport « The Limits To Growth » fait le point, 50 ans après… Il y a 50 ans Dennis Meadows co-publiait le rapport « Meadows » . Ce rapport est aussi appelé rapport du Club de Rome, ou « The limits to growth ». Il dit en bref qu’une croissance infinie dans un monde fini n’est pas possible et que tôt ou tard, nous allons atteindre des limites physiques et commencer à décroître. Et d’après les modélisations de l’époque, ce « tôt ou tard » arrive autour de 2030…
La croissance ne peut pas continuer pour toujours
Cela fait 50 ans que les conclusions de ces travaux sont discutées et débattues, mais aussi 50 ans que la modélisation informatique de l’époque fonctionne, que nous suivons une des trajectoires anticipées, celle où on ne change rien.
Alors que nous parlons de pic pétrole, de risques d’approvisionnements en métaux rares, de la nécessité de diminuer rapidement nos émissions, que la croissance économique ne semble plus reposer que sur de la dette, bref, alors que nous semblons atteindre les limites à la fois de notre planète, de nos ressources et de notre capacité à croitre, ce fameux rapport revient sur le devant de la scène.
Dennis Meadows a 79 ans, s’exprime aujourd’hui très peu dans les média, et c’est donc un honneur pour moi de l’avoir reçu dans Sismique pour faire le point sur sa vision des enjeux actuels.
Allons-y…
Il y a presque 50 ans, en 1972, vous et votre équipe du MIT (Massachusetts Institute of Technology) avez publié un rapport sur la croissance exponentielle de l’économie et de la population dans un monde aux ressources finies – étudiée au moyen de simulations par ordinateur – intitulé « Les limites à la croissance », également connu aujourd’hui comme le « Rapport Meadows » dont votre femme et vous étiez deux des quatre co-auteurs. La conclusion du rapport était que sans changements majeurs dans la consommation de ressources, le résultat le plus probable serait un déclin assez soudain et incontrôlable de la population et de la production industrielle.
Mise à jour de ce rapport en 1992 et une autre encore, dix ans plus tard. Mais la conclusion est restée la même.
C’est de ça dont j’aimerais que nous discutions au cours de l’heure à venir.
Pouvez-vous commencer par définir ce dont parle ce rapport, sa méthodologie, ses idées principales et ses conclusions ?
Il est bien sûr difficile de résumer deux ans de travaux en une réponse de deux à trois minutes, mais je vais faire de mon mieux.
Il est probablement impossible de s’en souvenir aujourd’hui, mais en 1970, l’idée générale répandue un peu partout – et certainement dans les pays riches et développés – était de s’attendre à ce que la population, l’économie, la qualité de vie et l’environnement continuent plus ou moins indéfiniment de s’améliorer. Ou pour aussi longtemps qu’on voulait bien le voir !
Mais c’est impossible : la croissance ne peut pas continuer pour toujours dans un monde qui est fini. Même une planète aussi grosse que la nôtre a des limites.
Donc pour avoir une meilleure perspective, j’ai réuni une équipe de 16 scientifiques au MIT où j’enseignais, et nous avons travaillé environ un an et demi afin de comprendre quelques-unes des lois de bases qui régissent la croissance de la population et de la consommation matérielle.
Il est bien sûr impossible de prédire l’avenir parce que les humains observent ce qui se passe et décident d’agir ; et ces actions, qui ne sont pas prévisibles, vont influencer le cours des évènements. Il est donc impossible de prédire ce qui va se passer, mais on peut en revanche prédire que de nombreuses choses ne seront pas possibles.
Pour vous donner un exemple banal : je peux prédire qu’au cours de cette interview, ni vous ni moi n’allons subitement échapper à la gravité et nous envoler de notre chaise. Je ne sais pas où vous serez d’ici trois à quatre minutes, mais vous ne serez certainement pas en train de flotter à deux mètres au-dessus de votre siège, et moi non plus. Donc notre rôle n’était pas de faire des prédictions exactes, mais plutôt de présenter un éventail de futurs possibles. Et parce que ces facteurs – la population, l’économie, etc. – changent lentement, nous avons regardé sur une période de 200 ans : de 1900 à 2100.
La période allant de 1900 à 1970, où nous avons mené cette étude, nous fournissait une perspective historique, et la période entre 1970 et 2100 correspondait à une durée sur laquelle nous pensions pouvoir apporter un éclairage qui puisse être utile aux décideurs et autres. Nous avons donc découvert ces lois et nous les avons intégrées dans un modèle informatique en utilisant une méthode qu’on appelle la dynamique des systèmes, qui ne se focalise pas sur les variables elles-mêmes, mais sur leur comportement.
Un exemple : si je jette une balle en l’air, je ne peux pas dire précisément où elle va atterrir, mais je sais que sa course va progressivement ralentir avant de retomber vers le sol. Je connais la dynamique générale, même si je ne connais pas les détails exacts, et il en va de même pour la planète. Nous avons envisagé 13 scénarios de futurs possibles pour la planète. Certains assez désirables, où la croissance physique se stabilise à des niveaux soutenables, où la population atteint une qualité de vie assez élevée et la pollution reste sous contrôle, etc. Et d’autres où nous ne faisons rien, où la croissance continue jusqu’à dépasser les limites de la soutenabilité avant de retomber à nouveau. Ces derniers étaient les plus spectaculaires et sont ceux que les médias ont évidemment repris pour caricaturer notre rapport. Et bien que nous n’ayons jamais utilisé le terme d’« effondrement » dans ce travail (parce qu’il implique beaucoup de choses hors de notre intérêt scientifique et de nos compétences), nous avons utilisé le terme de « déclin incontrôlable » : de réduction de la population, du niveau de vie matériel, de la consommation alimentaire peut-être, etc. qui échapperaient au contrôle de l’humanité. Cela resterait toujours gouverné par les lois de la physique, bien sûr, mais ce n’est pas le genre de choses que veulent les politiciens.
Nous avons donc mentionné ces questions et avons publié ce travail. Il y a eu en fait trois rapports publiés : « Les limites à la croissance » auquel vous vous référez a été repris, à notre grande surprise, traduit dans 35 langues et vendu à plus de trois millions d’exemplaires !
Notre rapport scientifique, un document de plus de 600 pages qui reprend toutes nos données, les équations du modèle informatique etc. a été largement moins distribué (rires). D’ailleurs je me suis souvent dit que j’aurais gagné du temps à réunir dans une même pièce ceux que notre travail scientifique intéressait pour le leur présenter directement, plutôt que de nous embêter à rédiger un pavé de 650 pages !
Et donc en 1992, nous avons mis le rapport à jour, nous avons étudié de nouvelles données, nous avons pu améliorer légèrement notre compréhension du développement technologique, et nous avons généré de nouveaux scénarios presque identiques à ceux que nous avions trouvés en 1972, parce que les lois physiques n’avaient évidemment pas changé depuis.
Et enfin, plus récemment, en 2004, nous avons publié un troisième rapport.
Il n’y aura pas de quatrième rapport, parce qu’il n’est désormais plus possible de générer tous ces scénarios : les scénarios les plus souhaitables, ne sont désormais plus vraiment atteignables.
Merci d’avoir essayé de résumer tout ça, je sais que c’est un exercice difficile pour une telle étude !
Ce qui est vraiment remarquable avec ce travail est qu’il reste toujours autant d’actualité, étant donné que ce que vous y décriviez devient visible aujourd’hui ; vos prédictions sont devenues des réalités. C’est aussi pour ça que nous devons nous y intéresser : vous avez abordé ces sujets depuis bien longtemps et nous en parlons encore.
J’aimerais tout d’abord comprendre comment ce travail a été reçu, dans les années 70, puis dans les années 90 lorsqu’on a fait les premiers constats, dont on a discuté alors. Quelles furent les réactions, les objections et les sujets dont vous avez longuement discuté ? Et est-ce que quoi que ce soit a été entrepris à ce moment-là ?
La réponse à notre livre n’a pas beaucoup changé, jusqu’à très récemment. Ce n’est qu’avec l’accélération des impacts visibles du changement climatique, la pandémie, et d’autres problèmes que les gens commencent à envisager cette idée qu’il puisse y avoir des limites à la croissance.
Pendant les quarante premières années, entre 1970 et 2010, c’était toujours un peu pareil. Je dirais qu’il y avait principalement trois types de réponses : les hommes politiques les plus ouverts (dont Sicco Mansholt, président de la Commission Européenne, Pierre Elliott Trudeau, premier ministre canadien, Jimmy Carter, président américain et un certain nombre de leaders européens) l’ont pris au sérieux et ont cherché à voir ce qu’il était possible de faire pour ramener le monde sur une trajectoire meilleure.
La deuxième réponse est venue des économistes, qui ont presque unanimement critiqué et condamné le rapport, parce qu’en acceptant l’idée de limites à la croissance, il faut admettre que le système économique moderne est largement inadapté, parce que c’est une « science » qui fait en sorte de promouvoir la croissance – particulièrement pour ce qui est de la macroéconomie.
Et il y a eu ensuite un petit groupe de politiciens pour qui nos résultats étaient gênants, parce que la croissance est une façon pour les politiciens – les politiciens démagos – d’arbitrer entre des demandes concurrentes. Si vous avez trois ou quatre personnes autour de vous qui en veulent plus que ce qui est disponible, pour pouvez leur dire de vous soutenir et leur promettre plus de gains pour l’avenir. Mais s’il est clair qu’il n’y aura rien de plus et que la croissance s’arrête, alors ce genre de compromis devient impossible. Donc ce petit groupe de politiciens a fait pression pour changer l’opinion en disant que nous voulions essayer de stopper la croissance afin d’empêcher les pays pauvres de se développer, que nous voulions injustement stabiliser les populations des pays pauvres, etc. Ils ont tout fait pour dévier la discussion.
Plus récemment, j’ai été fasciné de voir l’évolution du discours sur le changement climatique : nous n’avions pas prédit le changement climatique dans notre premier livre ; nous l’avions mentionné, mais en 1972 ce n’était pas encore un gros problème. Et ce n’est d’ailleurs pas un problème en soi, c’est un symptôme. Mais bref ! En regardant la façon dont les gens parlent du changement climatique, il y a une acceptation croissante de ce que nous pourrions avoir déclenché des forces totalement hors de contrôle. Et qu’il existe des limites à la quantité de gaz à effet de serre que nous pouvons rejeter dans l’atmosphère. Limites que nous avons malheureusement déjà dépassées.
Revenons à ce qui se passe aujourd’hui, parce que la plupart de vos prévisions se sont avérées correctes. Notamment celle qui imagine ce qui arriverait si nous ne faisions rien, le pire de vos scénarios, en somme. Et nous avons effectivement fait gonfler nos économies, les populations, le niveau de vie et en parallèle, les impacts sur la planète. Et nous pouvons en voir désormais une partie des conséquences.
Et pourtant, l’idée qu’il y ait des limites à la croissance et également que la croissance soit directement liée aux problèmes et aux défis qui se posent à nous, reste toujours une idée marginale.
Il y a quelques années, William Nordhaus a reçu un prix Nobel d’économie en affirmant que la croissance pourrait continuer indéfiniment et que le changement climatique pourrait même s’avérer bénéfique !
Que pensez-vous de ça et pourquoi pensez-vous qu’on puisse continuer de penser que les choses vont durer ainsi ? Pourquoi est-ce si difficile de comprendre [l’idée de limite] ?
Je trouve utile de garder à l’esprit que bien qu’il nous soit possible, à vous et moi, d’être assis là, séparés par plusieurs milliers de kilomètres et de discuter grâce aux technologies modernes, nous restons – du point de vue biologique et de la cognition -, vous, moi et le reste de notre espèce, le fruit de 200’000 ans d’évolution au bas mot. Et notre façon de voir les choses résulte d’une palette d’habitudes qui furent utiles à nos ancêtres, il y a 10, 20, 50 ou 100’000 ans. C’est le temps que prend l’évolution.
Dans les temps anciens, on ne consacrait pas de gros efforts à envisager des problématiques de long terme, à rechercher des solutions à des problèmes qui ne se poseraient pas avant une dizaine d’années. On prenait garde aux prédateurs, il fallait être prêt à partir au pas de course. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui nous essayons de résoudre des problématiques de long terme en utilisant un appareil de réflexion qui a évolué en ayant à résoudre des problématiques de court terme. Et ça ne marche pas !
Il est presque impossible à qui que ce soit d’envisager son avenir dans le contexte de ce qui sera d’ici 40, 50 ou 60 ans. Il nous est impossible d’imaginer que les choses ne vont pas simplement continuer à s’améliorer. Il nous est impossible d’imaginer que notre espèce ne soit pas la chose la plus importante sur cette planète : nous ne sommes pas équipés pour.
Comment je fais face à ça ? Je vais être un peu… hum…sarcastique, mais je vais le dire… Une attitude que j’ai adoptée est de considérer que c’est une planète mineure, en fin de compte : dans le grand ordre des choses, la Terre n’est pas si importante que ça. Donc ce qui se passe ici-bas ne va pas faire une grosse différence, il n’y a pas lieu de s’exciter plus que nécessaire. Et de plus, notre rôle sur la planète n’est pas si important. Je parlais récemment avec un ami, très soucieux des problèmes que j’évoquais, qui me dit : « Nous devons sauver la planète ! » J’ai répondu : « Non, nous n’avons pas à sauver la planète. La planète se sauvera elle-même ! C’est ce qu’elle a toujours fait au cours des derniers 200 millions d’années : elle s’est sauvée quand elle avait un problème. Qu’un astéroïde la frappe, qu’un volcan entre en éruption… et elle rétablit lentement un équilibre. Et c’est ce qu’elle fera encore. Notre problème à nous, c’est d’essayer de sauver des éléments que nous considérons comme important pour notre civilisation. Et c’est de ça dont on devrait se préoccuper.
J’ai donc revu mes préoccupations et je n’essaie plus d’éviter un déclin, parce que je crois que ça fait partie de la donne, c’est probablement déjà en cours. Ça l’est pour certaines personnes, en tout cas. Nous ferions mieux, au lieu de rechercher la soutenabilité, de penser en termes de résilience : comment structurer un système, votre famille, votre maison, votre entreprise, votre communauté etc. pour s’adapter aux chocs qui viennent, au changement climatique, à de futures versions de la pandémie etc.
Oui, nous allons y venir, mais je voudrais mentionner quelque chose : quand je vous ai contacté pour cet entretien et que je vous ai parlé de mon podcast, vous avez accepté, tout en m’écrivant quelque chose d’intéressant, je cite : « On peut considérer ce genre de discussion comme étant essentiellement un divertissement pour ceux qui partagent déjà ces idées. C’est sympathique, mais on ne changera l’opinion de personne avec ça. » Et je me suis dit que c’était un point intéressant à aborder.
Quel est votre avis sur ceux qui essaient de faire bouger les choses, les militants, les activistes en tout genre qui se battent pour faire entendre ce discours, pour essayer de lancer le débat et des initiatives sur ces questions. Est-ce juste une perte de temps ? Est-ce qu’on se pose les mauvaises questions ? Est-ce que ce n’est pas la bonne approche ?
Non… Vous savez, j’ai enseigné pendant 50 ans. Ma joie, mon but était d’aider les gens à garder une attitude optimiste envers l’avenir et à comprendre ce qu’ils pouvaient faire. Quelle que soit la situation, on aura toujours la possibilité d’aller vers un avenir soit pire, soit meilleur qu’il aurait pu être. Et s’il n’est plus possible d’aller vers l’avenir tel qu’on voudrait exactement qu’il soit, parmi les futurs possibles, certains restent plus désirables que d’autres. Je pense que c’est notre devoir moral à tous de faire tout ce que nous pouvons pour prendre la meilleure voie possible.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner deux pistes que je partage avec les gens qui se demandent quoi faire.
Tout d’abord, je pense qu’au lieu de rechercher la soutenabilité – qui n’est plus vraiment une option, ou du moins telle qu’on la définit, pour la population mondiale – il faut chercher des moyens de résilience : rechercher des façons de renforcer notre capacité à réagir aux chocs qui peuvent nous prendre par surprise. Nous savons que le taux de ruptures à venir s’accroît. Nous savons que l’intensité de ces perturbations s’accroît, qu’il s’agisse du changement climatique, de l’escalade du débat sur le nucléaire, des changements dans les systèmes énergétiques, quoi que ce soit… elles arrivent. Et il est à la fois utile, possible et satisfaisant d’augmenter nos capacités à faire face aux perturbations, même si on ne sait pas exactement d’où elles viendront. Donc résilience au lieu de soutenabilité est le premier concept.
Le second concept est ce que j’appellerais les problèmes « universels » plutôt que les problèmes « globaux ».
Les problèmes globaux sont ceux qui touchent toute l’humanité, mais qu’on peut uniquement résoudre par des actions concertées entre toutes les parties. Le changement climatique, la prolifération nucléaire, gérer la pandémie: ce sont des problèmes globaux. Il n’est pas possible de résoudre le changement climatique pour la France sans que les autres nations ne coopèrent également. Il n’existe pas de façon pour un pays de s’isoler de la pandémie, sans que la pandémie ne soit ramenée à zéro de partout. Ça ce sont les problèmes globaux.
Les problèmes universels affectent tout le monde, mais il est possible de les résoudre localement.
Prenons la pollution de l’eau : c’est un problème qu’on rencontre partout dans le monde. Mais en France ou aux Etats-Unis, en Corée du Sud ou dans un petit village, il est possible de remédier à la pollution de l’eau et vous obtenez ainsi des bénéfices immédiats. Donc les problèmes universels sont beaucoup plus faciles à traiter d’un point de vue politique. Dans ce cas, les dirigeants peuvent dire que si vous êtes prêt à accepter aujourd’hui certains sacrifices, vous obtiendrez rapidement des bénéfices en retour.
Les problèmes globaux sont, eux, politiquement difficiles à résoudre, parce que les dirigeants doivent dire dans ce cas que si vous acceptez des sacrifices ici et maintenant, c’est ailleurs que la plupart des bénéfices iront, et plus tard. Et ceci ne constitue pas une base sur laquelle la plupart des politiques peuvent être réélus. C’est pourquoi ils n’aiment pas le faire.
Par conséquent, si quelqu’un veut s’engager activement, je lui dirais de rechercher des façons d’augmenter la résilience et de se concentrer sur les problèmes universels, plutôt que sur les problèmes globaux.
Je voudrais prendre un exemple avec le changement climatique, parce que le sujet de cette discussion est aussi de savoir identifier les bons problèmes auxquels nous atteler.
Si nous parlons du changement climatique, puisqu’on considère que c’est le sujet le plus au centre du débat actuel… si la croissance s’arrête et que les déclins de la population, de l’économie et de notre consommation énergétique arrivent réellement, alors nous sommes peut-être en train d’adresser la question du changement climatique et d’une partie de la crise environnementale de façon assez mécanique.
Diriez-vous que c’est le changement climatique qui est le problème le plus pressant ou devrions-nous plutôt nous préoccuper des conséquences de ces déclins et de comment maintenir une civilisation fonctionnelle ici et là ?
Si je vous comprends bien, il est aussi question du niveau auquel nous pouvons agir : localement ou globalement ?
Je pense qu’il est tout d’abord important de comprendre que le changement climatique n’est pas un problème en lui-même. C’est un symptôme. Le problème sous-jacent est la croissance physique continue de population et de la consommation matérielle dans un monde fini. Le changement climatique est une conséquence de cette croissance continue. Tout comme l’érosion des sols, la pandémie et beaucoup d’autres choses sont également des symptômes de ce qui se passe quand on soumet les écosystèmes à des pressions.
C’est un peu comme si vous avez un ami atteint d’un cancer et que le cancer lui donne des maux de tête : vous voulez bien sûr lui faire passer ses maux de tête, mais il est clair que les maux de tête ne sont pas le problème. Les maux de tête sont un symptôme. Il peut être utile de lui donner de l’aspirine, mais vous n’imaginez pas avoir résolu son problème. Vous avez simplement soulagé les symptômes. Pour vous débarrasser du cancer, il faut se concentrer directement sur lui. Pour que nous puissions nous débarrasser du cancer de la croissance continue, c’est sur elle qu’il faut directement nous concentrer.
Vous dites : « si » la croissance ralentit… eh bien j’ai une nouvelle : la croissance ralentit, et va continuer à ralentir à l’avenir. Il n’y a virtuellement aucune chance pour que le genre de croissance que nous avons connue, disons dans les années 90, puisse continuer.
Quand exactement la croissance va s’arrêter et commencer à décliner ? Ça, ce n’est pas clair et ce sera différent selon les endroits du monde. Certains pays voient déjà diminuer la croissance de leur population. La population d’autres pays va continuer à croître pendant encore 20, 30 ans ou plus. Les gens auront des expériences différentes selon les endroits. Mais d’ici, je dirais la fin du siècle, la population sur cette planète, la consommation matérielle, l’utilisation d’énergie, la production alimentaire, tous les indicateurs d’activité physique seront bien en-dessous de ce qu’ils sont aujourd’hui.
Ce qui est aussi étonnant, c’est que d’après vous, nous n’avons aucune chance de pouvoir volontairement limiter notre croissance et donc de résoudre le problème à sa base. Et donc, si je comprends bien, vous dites qu’elle ne continuera qu’à certains endroits, jusqu’à ce que la croissance ne puisse pas aller plus loin. C’est bien ça ?
Oui. Rappelez-vous : vous m’avez dit un peu plus tôt que nos prédictions avaient été correctes. Mais nous n’avions en fait pas fait de prédictions : nous avions présenté 13 possibilités différentes.
L’une des possibilités montrait une croissance qui atteignait un pic dans la période que nous vivons, entre 2020 et 2050, avant de décliner plus ou moins continuellement. Nous n’avions pas prédit que c’était ce qui allait se passer, mais après avoir comparé plusieurs études basées sur des données empiriques recueillies au cours des 30 ou 40 dernières années avec nos scénarios, c’est bien l’avenir qui semble se profiler devant nous.
Dire que la croissance va diminuer n’est pas en soi une chose alarmante, parce qu’on pourrait parfaitement imaginer la réduire à travers des actions que nous entreprendrions et ramener les conséquences à des niveaux qui nous sembleraient acceptables.
Prenez la population par exemple : la population s’accroît lorsque le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité. Si vous voulez réduire la population – ce qui arrivera d’une manière ou d’une autre – cela veut dire que le taux de natalité deviendra inférieur au taux de mortalité. Il y a deux façons d’arriver à cela : nous pouvons délibérément réduire le taux de natalité ou nous pouvons attendre, ignorer le problème et laisser l’environnement subir des transformations qui d’elles-mêmes viendront augmenter le taux de mortalité. La première est une solution attrayante, la seconde, non. Nous avons toujours ce choix, en théorie.
Venons-en à la résilience, qui est désormais, d’après vous, ce sur quoi nous devrions nous concentrer et qui revient à dire : voilà ce qui va arriver, quoi que nous fassions, donc nous devons nous préparer aux conséquences.
Comment devraient s’y préparer les Etats-nations, par exemple ? Et pensez-vous que les systèmes politiques en place permettent réellement aux Etat-nations d’y parvenir ?
Il y a eu une tendance à approcher ces problèmes, prenons la pandémie ou le changement climatique par exemple, comme s’il y avait besoin d’un changement de règles pris en haut de l’échelon politique : si les Etats-nations pouvaient d’eux-mêmes y parvenir d’une manière ou d’une autre, si on pouvait faire quelques ajustements au niveau du gouvernement alors les problèmes seraient résolus. C’est tout simplement faux !
Le problème fondamental se situe au niveau de l’individu : aussi longtemps que l’individu assimilera la notion de progrès à un taux de transformation, ou comparera sa situation personnelle à celle du voisin (qui évidemment fait la même chose de son côté), aussi longtemps que nous aurons ce genre de système, il conduira à un effondrement, parce qu’il n’est tout simplement pas apte à parvenir à une stabilité, à arrêter la croissance.
Je crois quel n’importe quel système de gouvernance est compatible avec la durabilité, n’importe lequel pourrait nous amener à la résilience : démocratie, dictature, monarchie, hiérarchie tribale… tous les modes de gouvernance qui ont existé au cours des derniers 200’000 ans. N’importe lequel pourrait, en théorie, être acceptable, mais pas s’ils sont menés par des gens qui ont des visions à très court terme et qui recherchent activement la croissance.
Quand je fais remarquer que la démocratie n’est parvenue d’aucune façon significative à traiter le problème du changement climatique, les gens supposent que je préconise une autre forme de gouvernance : dictature, communisme ou autre. Mais non : je suis personnellement très heureux de vivre et d’avoir grandi dans une démocratie ! Reconnaître qu’il y a des problèmes ne veut pas dire qu’un autre système n’en aurait pas rencontré autant. Je crois que n’importe lequel en aurait rencontré, tant que nous ne parviendrons pas à changer de vision.
Je crois que ce qui se passera, c’est que nous ne changerons pas de vision. Et le système entre, d’après moi, dans une phase de désintégration, de découplage, au point que d’ici un siècle ou deux nous serons revenus à de plus petits groupes, qui pourront avancer dans un contexte beaucoup plus restreint.
Un des aspects les plus terribles de notre situation actuelle est que les actions entreprises par les Etats-Unis, ou la France ou le Botswana… (bon, le Botswana, un peu moins) se répercutent et ont des conséquences globales.
Il y a 2000 ans, nous avions trois grandes civilisations : la Chine, la Perse et les Romains. Chacun des trois pouvait se développer et s’effondrer sans trop de conséquences pour les deux autres. Mais aujourd’hui, un trader sur les marchés financiers aux Etats-Unis peut exécuter des instructions informatiques et faire s’effondrer l’économie d’un autre pays !
Nous ne sommes pas équipés pour gérer un tel niveau d’interdépendance et je pense que ce qui va arriver est que le système va évoluer d’une manière qui n’est désormais plus indispensable.
Donc vous prédisez, d’une certaine façon, la fin de la civilisation telle que nous la connaissons, et que nous allons vers quelque chose de différent, qui reste à inventer ?
Encore une fois, il faut éviter d’utiliser le terme de prédiction : vous pouvez prédire une éclipse lunaire, mais vous ne pouvez pas prédire le futur de l’humanité. À nouveau, vous pouvez dire ce qui ne peut pas arriver, mais il reste un large éventail de futurs possibles.
Je crois qu’il est important de se souvenir… j’ai presque 80 ans, et j’ai grandi dans un monde très différent de celui-ci. J’ai grandi dans un monde ou la consommation d’énergie par individu représentait une petite fraction de ce qu’elle est aujourd’hui. Les déplacements en jet n’existaient pas, il n’y avait pas d’ordinateurs… Donc je sais qu’il est parfaitement possible d’avoir une société fonctionnelle, avec une population suffisamment heureuse, éduquée, bien répartie, dans des circonstances très différentes de ce qu’on connaît à l’heure actuelle. Si aujourd’hui, je dis à quelqu’un qu’il devrait réduire sa consommation énergétique de moitié – ce qui m’est d’ailleurs arrivé tout récemment – la réponse immédiate de la personne a été : « Oh, vous voulez nous renvoyer à l’époque des cavernes ! ». Je réponds : « Non ! Nous pourrions revenir aux années 50 : j’ai grandi dans les années 50 et c’était une époque tout à fait agréable. Et la consommation d’énergie était de moins de la moitié de ce qu’elle est aujourd’hui. »
Il y a donc beaucoup de possibilités. Notre espèce en a expérimenté de nombreuses au cours des derniers 200’000 ans, et souhaitons qu’elle en connaisse encore beaucoup d’autres durant les prochains 200’000 ans ! Mais elle ne connaîtra pas le genre de société à forte consommation, au confort matériel élevé et extrêmement énergivore que nous autres, dans les pays riches – essentiellement blancs et du Nord – sommes venus à considérer comme un modèle souhaitable et incontournable.
Qu’est-ce que ce sera ? Je ne sais pas. C’est une question intéressante !
Vous dites que vous vous adressez à de nombreux étudiants, que vous continuez à donner des conférences. Quelle est donc la bonne question à poser ? Est-ce que c’est de savoir comment on s’adapte, comment on se prépare à quelque chose de très différent, au lieu d’essayer de viser la soutenabilité ?
Comment formuleriez-vous la question ?
Je dirais que la question importante est : comment faire en sorte que les gens se soucient de l’avenir lointain et se soucient de personnes qui sont éloignées et différentes d’eux ? Si chacun d’entre nous pouvait avoir ce niveau de préoccupation, nous pourrions créer des systèmes politiques, des technologies et mêmes des modes d’économie pour satisfaire ces objectifs.
Des gens ont recherché des solutions au changement climatique, par exemple, à travers de petits ajustements de notre système politique et économique actuel. Le système politique et économique actuel est l’expression de la volonté et des objectifs des gens. Et si ces derniers ne changent pas, vous ne changerez pas les résultats qu’ils produisent…
Cela m’amuse toujours : un des débats actuels concerne les Organismes Génétiquement Modifiés, et les partisans de ces technologies génétiques prétendent qu’elles permettront de remédier aux problèmes de famines. C’est parfaitement absurde : les problèmes de famines ont été créés par un groupe d’institutions qui, si on les dotait d’outils plus performants, continueraient à engendrer des famines. Nous pourrions éradiquer les famines dès aujourd’hui, avec les technologies dont nous disposons déjà, si cela nous importait autant que ça ! Ce n’est pas le cas.
La question cruciale est donc : comment nous changer nous-mêmes ? Si nous parvenons à nous changer, notre système changera. Si nous ne changeons pas, nous pouvons changer le système autant qu’on veut, il donnera toujours les mêmes résultats.
Avez-vous une idée ?…
Parce que vous parlez là de changer de culture, si je vous comprends bien : il s’agit de changer les gens à une grande échelle, leur façon de voir le monde. C’est une question de culture. Avez-vous une idée de comment on met ça en place ?
La religion est traditionnellement la façon dont les gens ont formé et propagé leur éthique collective. Il existe beaucoup de religions différentes : hindouisme, islam, bouddhisme, shintoïsme, christianisme, etc. Certaines religions anciennes, le bouddhisme par exemple, ont dû intégrer quelques-uns des principes éthiques nécessaire à une société soutenable. Si une religion ne transmet pas les principes éthiques dont vous avez besoin pour promouvoir un comportement soutenable, elle finira par disparaître. Je regarderais donc du côté de certaines des religions les plus traditionnelles pour trouver des lignes directrices sur cette question.
Et je dis ça, bien qu’étant un scientifique qui tend à avoir une vision plutôt objective du monde. Cependant, la spiritualité joue un rôle absolument essentiel et c’est de ce côté-là que j’irais chercher. Les gens demandent parfois : de quelles technologies avons-nous besoin ? De quel nouvel outil ? Je dirais qu’il est prématuré de poser cette question. Ce dont nous avons besoin est d’un horizon de temps plus long. Nous avons besoin, à travers nos institutions et de par nous-mêmes, d’intégrer des procédures, des habitudes, des mécanismes pour ramener nos actions actuelles dans le contexte de leurs conséquences à très long terme.
De nos jours, un politicien va évaluer les alternatives en fonction de ce dont elles auront l’air entre maintenant et les prochaines élections. Et s’ils peuvent faire en sorte que les choses aient l’air d’aller un tout petit peu mieux d’ici les prochaines élections, ils seront bien placés pour les emporter ! Si je vais voir des politiciens et que je leur dis : « Voici ce qu’il faut faire, mais cela va rendre les choses plus difficiles pendant quelques décennies, avant que la situation ne s’améliore », ils ne seront pas intéressés. Parce qu’en suivant cette voie, il leur serait impossible d’accéder au pouvoir.
Vous avez là un exemple de comment le système fonctionne et peut bloquer les changements…
Oui, absolument ! Voilà une des sérieuses difficultés de notre situation : nous avons développé ces systèmes très élaborés – systèmes techniques, systèmes économiques, systèmes gouvernementaux – qui ne nous amènent pas vers un futur soutenable, manifestement.
Je veux dire que ça n’est plus discutable : prenez juste l’augmentation annuelle d’émissions de CO2. Ces systèmes de gouvernance ne fonctionnent clairement pas sur le long terme ! Mais ces mêmes systèmes génèrent énormément de puissance, énormément de richesse pour de nombreuses entités.
Prenez les compagnies pétrolières : les compagnies pétrolières ont fait des milliards et des milliards de dollars de profit en faisant la promotion de politiques qui ne correspondent pas à l’intérêt général en matière de durabilité sur le long terme, mais qui sont parfaites pour leurs actionnaires à court terme.
Maintenant, lorsqu’un politicien ou un autre leader commence à promouvoir une politique rationnelle qui changerait le système, la réponse immédiate de ceux qui bénéficient du système actuel est de l’entraver. Ceci est très manifeste dans mon pays, bien plus que dans le vôtre, où chaque initiative visant à essayer d’apporter une solution constructive est immédiatement bloquée par ceux qui pensent que le changement les désavantagerait. Et parce qu’il est plus facile de stopper quelque chose que de le promouvoir, cela signifie que nous nous retrouvons prisonniers de cette situation…
A quel niveau faut-il alors agir ? Est-ce qu’il faut juste regarder autour de soi, là où l’on vit, avec sa famille, ses voisins ? Où recommandez-vous d’agir à ceux qui veulent faire quelque chose et s’y préparer ? Quel est votre conseil ?
Lorsque vous demandez ce qu’on peut faire, la question est bien sûr de savoir quel est votre objectif.
Si votre but est d’avoir une vie confortable pour vous-même, il y a une série d’actions que vous pouvez entreprendre, mais si vous vous préoccupez avant tout du changement climatique, les actions envisageables sont tout autres. Il n’y a donc pas de réponse abstraite universelle à cette question. Il faut regarder les conditions spécifiques.
Lorsque je fais des conférences, des gens viennent souvent me voir pour me demander quoi faire. Je prends cette question au sérieux, mais la réponse sérieuse est : « Il faudrait que nous en discutions pendant une demi-heure, avant que je puisse avoir une base quelconque sur laquelle formuler une réponse : quels sont vos objectifs ? Quelles sont vos ressources ? Quelles sont vos contraintes ? Qui d’autre partage les mêmes intérêts que vous ? » C’est seulement après avoir répondu à ces questions que vous pourrez commencer à mettre au point un plan d’action concret.
Je le répète : il existe des plans d’actions concrètes et positives à la portée de chacun d’entre nous, quel qu’il soit ! Tout le monde, petit ou grand, a en permanence le choix entre de nombreuses actions : certaines peuvent participer à rendre la situation pire qu’elle n’aurait été, et d’autres à la rendre meilleure qu’elle n’aurait été. Et notre challenge est bien sûr d’identifier ces dernières.
Puisque vous avez mentionné la nécessité de changer la culture, pour éviter les pires trajectoires, j’imagine que vous avez des idées sur le genre de valeurs que quelqu’un devrait par exemple inculquer à ses enfants, pour être résilient ou pour commencer à construire un autre genre de culture ?
Je suis un type très concret, vous savez. J’ai du mal avec les questions théoriques et abstraites ; j’aime le concret.
Une de mes amies proches est maman ; elle est venue me voir en disant : « Je crois à ta vision de l‘avenir. J’ai deux garçons en bas âge ; que devrais-je leur apprendre pour qu’ils puissent mener une vie longue et satisfaisante ? »
Qu’est-ce que j’ai répondu ? Là, j’ai un problème concret à résoudre.
Donc voici quelque chose que je lui ai dit : « Enseigne-leur des compétences manuelles : comment faire de la plomberie, comment assembler des tuyaux, comment faire des travaux d’électricité… des compétences pratiques : comment faire pousser des légumes, etc. Pas pour en faire leur métier, mais comme des choses auxquelles ils pourront toujours avoir recours. Apprends-leur qu’être heureux signifie avoir assez, et pas toujours avoir plus. »
Et voilà une expérience intéressante : allez voir vos amis et demandez-leur s’ils sont heureux et demandez-leur pourquoi. Il y a de fortes chances pour qu’ils fassent référence à des changements quantitatifs : « Je suis heureux parce que j’ai plus d’argent, ou une plus grande maison, ou une voiture plus rapide… que l’année dernière. Et l’année prochaine, je pourrais probablement être encore plus heureux si elle était encore plus rapide, plus grande etc. »
Mais le bonheur peut aussi consister à avoir assez. Il y a deux façons d’être heureux. Et que veut-on dire, déjà, par être heureux ? C’est obtenir ce que l’on veut, par définition. Si vous n’avez pas ce que vous voulez, alors vous n’êtes pas heureux. Et si vous n’êtes pas heureux, il y a deux façons de le devenir : avoir plus ou vouloir moins. Vouloir plus conduit à l’effondrement. Vouloir moins permet de jeter les bases d’un avenir durable. Ce n’est pas une garantie, mais une possibilité.
On approche de la fin…
Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir pour les décennies à venir ?
(Rires) Là encore, j’ai mes propres aspirations. J’espère être encore en vie d’ici une vingtaine d’années ! Ça me rendrait déjà très heureux.
Pour ce qui est de la planète, je sais que d’ici vingt ans, le climat sera beaucoup moins favorable pour nous qu’il ne l’est actuellement. Il n’y a rien que nous puissions faire aujourd’hui pour éviter que le climat ne se modifie encore pendant plusieurs siècles, peut-être même plusieurs millénaires.
Cela ne veut pas dire que réduire les émissions de gaz à effet de serre et prendre d’autres mesures ne serve à rien ! Cela veut seulement dire que ça ne nous ramènera pas à ce que nous avons connu pendant les années 90.
Je souhaite que les gens puissent commencer à avoir une compréhension réaliste des options qu’ils ont, au lieu d’imaginer ou d’espérer que les problèmes disparaissent et que la situation redevienne « normale ».
C’était d’ailleurs fascinant d’observer la progression de la pandémie et de comment elle a impacté l’économie : les gouvernements, de partout, ont dépensé des quantités phénoménales d’argent pour essayer désespérément de maintenir l’activité… jusqu’à quoi ? Jusqu’à ce qu’elle puisse revenir à ce qu’elle était avant. Mais ça n’arrivera pas !
J’ai observé le mouvement de la décroissance, qui est, me semble-t-il, probablement né en France. Le terme de décroissance revêt en français une signification supérieure à sa traduction anglaise. Je souhaite que les principes fondamentaux de la décroissance puissent être largement plus acceptés, suivis et respectés. Malheureusement ça n’arrivera pas avec le nom actuel…
Je ne suis vraiment pas satisfait du terme de décroissance comme logo ou comme étendard pour ce mouvement, parce que c’est un terme intrinsèquement négatif. Si vous allez voir des politiciens en leur disant : « J’ai envisagé quelques mesures pour promouvoir la décroissance, voudriez-vous les entendre ? », la plupart ne seront pas intéressés. Une amie japonaise qui m’est chère voulait créer un mouvement de décroissance au Japon. J’ai dit : « C’est super, mais ne l’appelle pas comme ça ! » Elle a donc baptisé sa société l’Institut d’étude sur le Bonheur (ISHES). Mêmes objectifs, mêmes principes. Mais maintenant, lorsqu’elle va voir un politicien en disant : « J’aimerais discuter avec vous de mesures visant à davantage de bonheur, seriez-vous intéressé ? », là, la personne veut bien lui accorder de son temps pour en discuter. Même s’il s’agit de la même chose, ce n’est qu’une affaire d’étiquette.
J’espère que nous pourrons traverser cette période de transition sans connaître de conflits violents. J’entends : on peut envisager de nombreux scénarios, si on considère les armes disponibles aujourd’hui, où certains pays refusant ce qui les attend pourraient être tentés de l’éviter désespérément en contraignant d’autres régions d’une manière ou d’une autre. Ça peut se terminer en conflit. Donc c’est une des choses que j’espère : que nous pourrons éviter les affrontements. Rien dans un conflit armé ne rendra nos problèmes plus simples à résoudre !
J’espère que les polarisations auxquelles on assiste, entre différentes religions, différentes idéologies politiques puissent se modérer et les gens s’intéresser davantage aux faits réels qui sont derrière.
Il y a deux façons de se faire une opinion : l’une est d’identifier les faits pertinents, les étudier, et ensuite d’adopter l’opinion que confirment ces faits – c’est ce qui m’a amené à croire en l’existence du changement climatique. L’autre façon est de décider de l’opinion qui vous plaît, et ensuite de rechercher des faits qui viennent la confirmer. C’est là l’approche de ceux qui continuent à nier le changement climatique ou qui nient l’efficacité des vaccins contre le virus, etc. Je souhaite que nous puissions revenir à cette première façon de penser. Je ne suis pas particulièrement convaincu que cela va se produire, mais vous m’avez demandé ce que j’espérais; en voilà un exemple.
Merci beaucoup ! Une dernière question, qui est souvent difficile : y a-t-il un ou deux livres que vous conseilleriez de lire… dans cette vie ? (rires)
Oui, là je suis embarrassé, parce qu’une partie de la meilleure littérature au monde a été écrite en français, une langue que je ne maîtrise pas. Je ne suis donc pas familier avec une partie des meilleurs ouvrages de votre pays.
Je ne peux pas vous faire de recommandation personnelle, mais je peux en citer quelques-uns qui ont beaucoup influencé ma pensée – et je suis sûr qu’on peut trouver d’autres ouvrages équivalents en français…
Un des livres les plus importants que j’aie lus s’intitule, en anglais : The Structure of Scientific Revolutions (La structure des révolutions scientifiques, par Thomas S. Kuhn).
C’est une description de comment les paradigmes – les images mentales des gens, leurs modèles de pensée, d’organisation – peuvent basculer. Pour l’illustrer, il cite l’exemple du débat qui a eu lieu sur la formation des continents : lorsque j’étais jeune, à l’école, on m’a appris que les grands continents (continent américain, continent européen, etc.) avaient été formés par des pluies, qui en tombant sur les montagnes auraient conduit à l’érosion des terres, évacuées dans les mers, façonnant ainsi nos continents.
Quelque temps plus tard, la recherche scientifique envisageait que les continents provenaient d’un un seul grand bloc de terre émergée qui se serait lentement fragmenté en plusieurs morceaux ayant dérivé à la surface de la planète.
Cela semble évident aujourd’hui ; plus personne ne remet ça en cause. Mais il y a eu des décennies de débat houleux entre les géologues qui avaient bâti leur réputations et leur carrières sur l’idée de l’érosion d’une masse de terre et les jeunes scientifiques qui arrivaient en regardant les données et disaient : « Non, ça ne s’est pas passé comme ça ! » Il n’était pas question de faits scientifiques, mais de réputations et de carrières… Et donc à cette époque, malgré des données observables assez claires, les disputes ont duré des décennies.
Dans d’autres domaines, avec la pandémie aujourd’hui, ou le changement climatique, ou comment gérer les inégalités… il y a d’énormes désaccords.
Nous avons suivi une série de paradigmes qui ont plutôt bien fonctionné au cours des deux derniers siècles. Mais ils ne fonctionnent plus. Les paradigmes qui soutiennent nos systèmes de gouvernance, nos systèmes économiques, etc. étaient bien adaptés à une période à laquelle la croissance était possible. Ils ne fonctionnent pas dans une période où la croissance n’est plus possible et il nous faut en changer.
Le livre de Thomas Kuhn m’a donné un exemple intéressant de combien ceci est difficile.
Il existe beaucoup d’autres exemples concrets : on peut étudier les énormes difficultés rencontrées dans les théories de navigation, pour mettre au point la technologie qui a permis aux navires de connaître leur longitude. Question cruciale, mais il a fallu là aussi des décennies de disputes entre horlogers et astronomes pour décider de la bonne méthode.
Nous sommes actuellement dans une période similaire, où le paradigme de la décroissance est en conflit avec le paradigme de la croissance. Et la transformation est en cours. D’ici 100 à 200 ans, ces choses seront résolues.
Le livre de Thomas Kuhn donne un éclairage intéressant pour comprendre comment se produisent ces changements.
Une deuxième catégorie de livres que je trouve très utiles sont ceux sur ce que j’appelle «l’Histoire longue». Ce sont les livres qui étudient les dynamiques physiques, sociales et politiques sous-jacentes dans le fonctionnement des empires : les Romains, les Phéniciens, les Mongols, la dynastie Han en Chine, les Carthaginois, etc. Apprendre comment une société se forme et s’organise, comment le système se développe, devient plus puissant, atteint une apogée et finit par décliner.
Comprendre que nous ne sommes pas à l’abri de ces forces, que nous en faisons partie, permet un certain détachement et une meilleure perspective pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui.