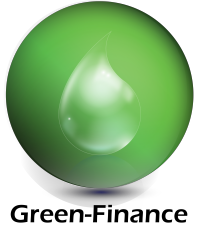A l’heure où le gouvernement est accusé d’improviser sa stratégie énergétique, Henri Wallard met les mots sur un mal plus profond : l’imposture écologique de l’État français.
Un ancien haut dirigeant dévoile les coulisses d’un pilotage à vue. Nucléaire, hydrogène, rénovation, PPE…
Dans Mensonge d’État – Imposture écologique (Fayard, mars 2025), l’ancien haut fonctionnaire et ex-dirigeant d’Ipsos dresse un constat implacable : l’État navigue à vue, incapable de planifier, d’écouter la science, les citoyens ou les industriels.
Résumé : Livre écrit par Henri Wallard, publié en 2025 chez Fayard. Ce livre se présente comme une enquête percutante et un plaidoyer pour une approche plus rationnelle et cohérente de la crise environnementale en France.
L’auteur, ancien haut fonctionnaire et ex-directeur général adjoint d’Ipsos, y propose une critique incisive de la gestion politique de la transition écologique en France. Selon lui, l’État français fait preuve d’improvisation, d’incohérence et d’une dérive technocratique face aux enjeux climatiques, ce qui fragilise le pays plutôt que de le préparer à un avenir durable.
Les points clés abordés dans le bouquin :
1. Critique de l’improvisation et de l’incohérence politique :
Wallard met en avant l’absence de stratégie cohérente dans la politique écologique française. Il cite des exemples précis, comme le programme de leasing social pour les voitures électriques, lancé en grande pompe en 2023 pour encourager la mobilité verte, mais suspendu en 2024 faute de financement suffisant et d’anticipation logistique. Il met en lumière les détours sur le nucléaire : après des années d’hésitation, l’État a relancé des projets de réacteurs (EPR2) sans plan clair pour gérer les déchets ou former les ingénieurs nécessaires. Ces indécisions, selon lui, traduisent un manque de vision et une gestion réactive que proactive, qui décrédibilisent les ambitions écologiques affichées.
2. Dérive technocratique et déconnexion citoyenne :
L’auteur, fort de son expérience en tant que haut fonctionnaire, dénonce une gouvernance trop technocratique, éloignée des réalités du terrain. Il pointe du doigt la multiplication des comités, agences et plans (comme le “Plan 2030” ou la “Stratégie Nationale Bas-Carbone”), qui produisent des rapports et empilent des acronymes, mais sans réels effets concrets. Pour Wallard, cette approche met les citoyens à l’écart, les laissant spectateurs de décisions prises sans eux. Il illustre son propos avec l’exemple des éoliennes, souvent imposées sans véritable dialogue local, ce qui alimente frustrations et oppositions, et finit par nuire à la transition énergétique elle-même..
3. Un manque de rigueur scientifique et des annonces sans effet :
L’un des points clés du livre est la critique d’un manque de sérieux scientifique dans les politiques publiques. Wallard reproche aux dirigeants de privilégier des décisions spectaculaires, comme l’interdiction des chaudières à gaz, sans étude d’impact approfondie ni alternatives viables. Il dénonce aussi un “verdissement” de façade dans certaines industries, largement subventionnées sans réelle évaluation de leur efficacité écologique. Selon lui, cette approche repose sur des discours alarmistes ou idéalistes qui cachent une réalité plus crue : l’incapacité à transformer des objectifs ambitieux, comme la neutralité carbone en 2050, en mesures concrètes et efficaces.
4. Exemples concrets de fiasco :
S’appuyant sur son expérience à l’ANDRA, Wallard met en lumière la gestion chaotique des déchets radioactifs, symbole de l’inaction française. Malgré des décennies de débats sur le site de Bure, le traitement de ces déchets essentiels à la transition énergétique accumule un retard inquiétant. Il évoque aussi la rénovation thermique des bâtiments, où les aides comme MaPrimeRénov’ se heurtent à une bureaucratie kafkaïenne, décourageant autant les ménages que les artisans. Autant d’exemples qui, selon lui, illustrent un manque de pragmatisme et une incapacité à transformer les intentions en résultats concrets.
5. Propositions pour une restructuration :
Loin de se contenter de critiques, l’auteur propose des solutions concrètes pour améliorer la situation :
-Rigueur scientifique : Chaque décision doit être fondée sur des données fiables, accompagnées d’évaluations indépendantes des impacts environnementaux et économiques.
-Participation citoyenne : Mettre en place de véritables consultations publiques, inspirées des modèles scandinaves, élaborer de manière collaborative les politiques écologiques avec les citoyens.
-Vision industrielle : Relancer une filière énergétique et technologique française (comme les batteries ou l’hydrogène), afin de réduire la dépendance aux ressources étrangères.
–Fin des effets d’annonce : Privilégier des objectifs clairs, mesurables et progressifs, avec des bilans publics réguliers pour restaurer la confiance et assurer la transparence.
6. Un appel à une urgence réfléchie :
Wallard termine son ouvrage en soulignant l’urgence de la situation : malgré le potentiel considérable de la France (dans des domaines comme le nucléaire, la recherche ou l’agriculture), elle risque de manquer le tournant écologique par manque de courage politique. Il lance un appel à un sursaut collectif, loin des illusions d’un “capitalisme vert” ou des promesses vaines, afin de construire une transition qui soit à la fois pragmatique et ambitieuse.
À lire aussi : Commerce mondial en crise : protectionnisme et chaos